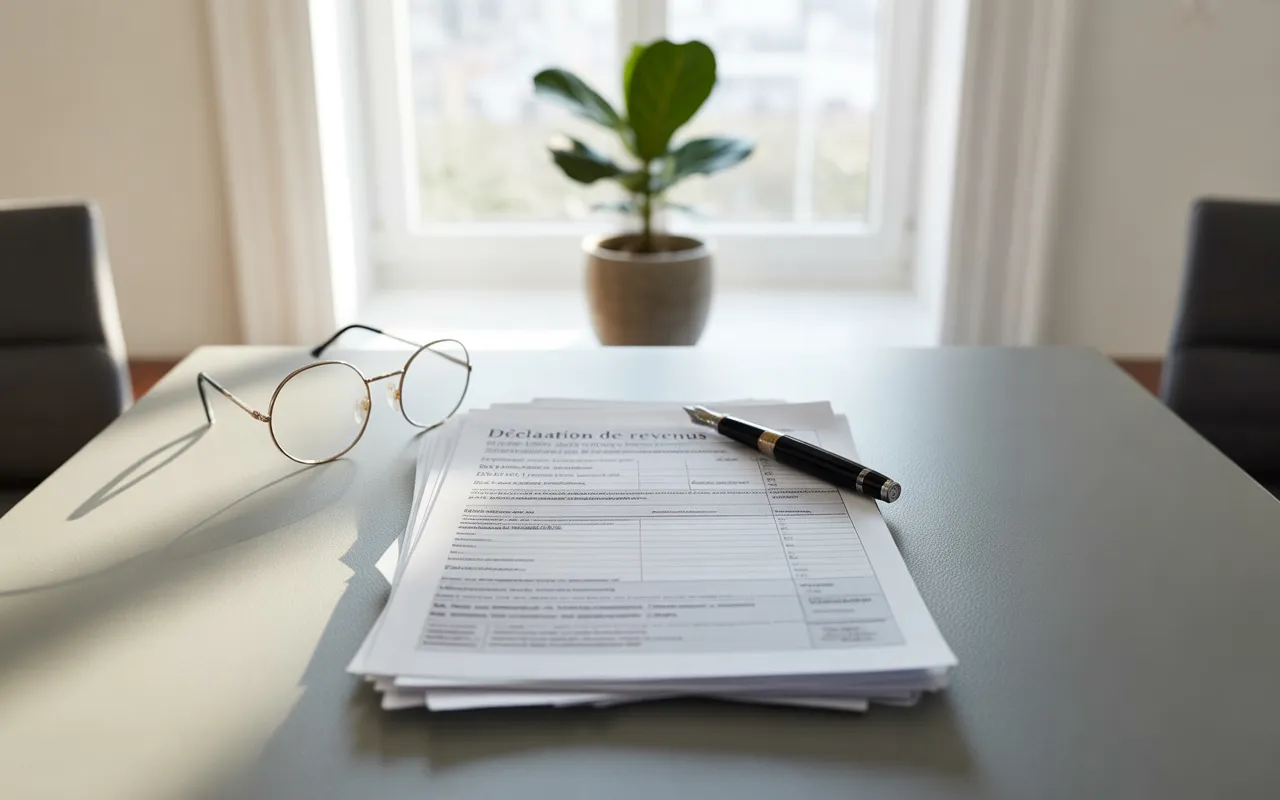La résidence fiscale en France détermine vos obligations déclaratives et l’étendue de votre imposition pour l’année 2025, qu’il s’agisse de revenus mondiaux, de placements ou de plus-values. À l’approche de la prochaine campagne déclarative, identifier clairement votre statut de résident fiscal devient un enjeu central, tant pour éviter la double imposition que pour vous prémunir contre les risques de redressement fiscal. Professionnels expatriés, investisseurs étrangers, particuliers ayant des intérêts patrimoniaux ou économiques en France : la définition précise de la résidence fiscale, au regard des critères fixés par l’article 4 B du Code général des impôts, est souvent le point de départ d’une gestion fiscale optimisée et conforme à la réglementation.En pratique, un particulier qui possède son foyer ou son lieu de séjour principal en France, ou qui exerce en France une activité professionnelle à titre principal, est réputé résident fiscal français. Pour l’imposition des revenus de 2024, la déclaration – habituellement réalisée via le formulaire n°2042, doit être déposée en ligne sur impots.gouv.fr avec des dates limites fixées, selon les départements, entre mai et juin 2025 (par exemple, le 25 mai 2025 pour une déclaration en ligne dans les départements 01 à 19, selon le calendrier fiscal publié). Les actifs ou revenus de source étrangère doivent alors être reportés sur la déclaration annexe n°2047, tandis que la détention d’un compte à l’étranger implique la production de l’imprimé n°3916. À titre d’illustration, un résident fiscal percevant 50 000 euros de salaires à l’étranger devra non seulement déclarer ce montant, mais également préciser les modalités d’imputation des éventuels crédits d’impôt selon l’application des conventions fiscales internationales (voir la convention modèle de l’OCDE).Toutefois, la détermination de la résidence fiscale et ses conséquences déclaratives s’avèrent particulièrement complexes en cas de mobilité internationale, de détention d’actifs numériques, d’investissements immobiliers à l’étranger ou de situation de double résidence, chacun de ces cas étant susceptible de faire l’objet d’une analyse spécifique, à la lumière de la législation nationale et des conventions bilatérales en vigueur. Il convient de rappeler que les indications présentées dans cet article sont exclusivement fournies à titre informatif et général. Chaque situation présentant des particularités, nous vous invitons à solliciter un accompagnement personnalisé auprès des professionnels de NBE Avocats, cabinet spécialisé en fiscalité française et internationale, afin d’obtenir un conseil adapté à votre configuration patrimoniale et fiscale.Visitez notre page d’accueil pour découvrir tous nos domaines d’expertise.
Les critères de la résidence fiscale selon la législation française
Les critères légaux posés par l’article 4 B du Code général des impôts
La détermination de la résidence fiscale en France est encadrée principalement par l’article 4 B du Code général des impôts (CGI). Selon cet article, une personne physique est considérée comme résident fiscal français si elle remplit l’un des quatre critères suivants au cours d’une même année civile :
- Foyer fiscal ou lieu de séjour principal en France : Le foyer est défini comme le lieu où la personne ou sa famille (conjoint et enfants) habite de manière habituelle, indépendamment des absences ponctuelles dues au travail ou à d’autres contraintes (détail dans le BOFIP sur la notion de foyer).
- Activité professionnelle principale en France : Il s’agit généralement de l’endroit où l’activité professionnelle est exercée, sauf si celle-ci est accessoire. Pour un travailleur indépendant ou salarié, si la durée ou la valeur économique de l’activité en France excède celle à l’étranger, le critère est rempli.
- Centre des intérêts économiques en France : Cela inclut le lieu où le contribuable tire la majeure partie de ses revenus, investit, gère ses biens ou a le centre de ses activités économiques (définition du centre des intérêts économiques).
- Cas particulier des agents de l’État : Sont considérés comme résidents fiscaux français, les agents de l’État exerçant leur fonction ou mission dans un pays où ils ne sont pas soumis à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.
Il est important de noter que le respect de l’un seul de ces critères suffit pour être fiscalement domicilié en France. En cas de doute ou de situation mixte, l’analyse précise de chaque élément de votre situation doit être réalisée afin d’éviter des requalifications par l’administration fiscale.
Illustrations pratiques de la définition de résidence fiscale
Prenons l’exemple d’un entrepreneur français expatrié à Londres qui conserve en France une résidence familiale où séjourne son conjoint et ses enfants. Même si cet entrepreneur passe la majorité de l’année au Royaume-Uni, il pourrait, au regard du CGI, être considéré comme résident fiscal français compte tenu de la localisation de son foyer.À l’inverse, une personne vivant seule à l’étranger, n’ayant conservé en France ni foyer, ni intérêts économiques substantielles, ni activité professionnelle principale, pourra perdre la qualité de résident fiscal français, à condition toutefois qu’aucun des autres critères ne soit rempli.
Appréciation chronologique de la résidence fiscale
L’administration fiscale examine la notion de résidence fiscale année par année. Ainsi, un départ ou une arrivée en cours d’exercice nécessite une attention particulière quant à la ventilation géographique des revenus et à la détermination précise du statut au 1er janvier de l’année concernée.Cela implique, pour la déclaration des revenus perçus en 2024 (à déposer en 2025), que toute modification de votre situation entre le 1er janvier et le 31 décembre soit clairement documentée et argumentée sur le plan fiscal.
Conventions fiscales internationales : articulation avec la définition française
Le risque de double imposition et le rôle des conventions bilatérales
La mobilité internationale croissante expose nombre de personnes à un risque de double imposition. C’est notamment le cas des particuliers expatriés, retraités mobiles ou dirigeants de sociétés transfrontalières. La France a signé près de 130 conventions fiscales internationales destinées à éviter la double imposition et à répartir le droit d’imposer entre la France et l’État de résidence concurrent (liste des conventions sur impots.gouv.fr).Chaque convention contient généralement une clause de « résidence », s’appuyant souvent sur la Convention modèle de l’OCDE, organisant des critères hiérarchisés pour déterminer la résidence fiscale unique du contribuable en cas de double qualification :
- Foyer d’habitation permanent
- Centre des intérêts vitaux (famille, affaires, fortune)
- Séjour habituel (nombre de jours de présence)
- Nationalité
- Procédures d’accord entre autorités compétentes
Exemple chiffré
Supposons qu’un contribuable, de nationalité française, possède un appartement à Paris pour ses retours en France (60 jours par an), dispose d’une habitation permanente à Lisbonne où réside sa famille, et tire l’essentiel de ses revenus de placements au Portugal et de salaires français. Selon la convention franco-portugaise, si son centre des intérêts vitaux est au Portugal et qu’il y séjourne plus de 183 jours, il sera rattaché fiscalement au Portugal, même si la France pourrait, en l’absence d’accord, revendiquer sa qualité de résident.
Procédure de résolution des conflits de résidence
En cas de litige ou de double imposition effective, il est possible d’activer la procédure amiable prévue au titre des conventions fiscales, voire d’engager un rescrit auprès de l’administration fiscale française (via le formulaire n°3950-SD) pour sécuriser la situation déclarative.
Conséquences pratiques de la résidence fiscale
Portée de l’imposition pour un résident fiscal français
Un résident fiscal français est imposable en France non seulement sur ses revenus de source française, mais aussi — et surtout — sur ses revenus de source mondiale. Cela comprend :
- Salaires, retraites, pensions, honoraires de source française et étrangère
- Revenus d’investissements ou de placements à l’étranger (dividendes, intérêts, plus-values mobilières)
- Revenus immobiliers perçus hors de France
- Plus-values sur actifs numériques détenus sur des plateformes étrangères
Pour tout savoir sur le régime fiscal applicable aux crypto-actifs et actifs numériques, consultez notre dossier thématique.À titre d’exemple, un salarié travaillant à l’international et percevant 100 000 € de revenus, dont 40 000 € sont des dividendes d’une société canadienne et 60 000 € de salaires français, devra déclarer ces deux composantes sur sa déclaration n°2042, avec report des revenus étrangers sur l’annexe n°2047. Il devra également, le cas échéant, appliquer les mécanismes de crédit d’impôt ou d’exonération prévus par les conventions fiscales.
Les obligations déclaratives spécifiques aux non-résidents
À l’inverse, un non-résident fiscal français n’est imposable en France que sur ses revenus de source française (ex : location d’un bien immobilier situé en France, revenus de source française perçus par un dirigeant extra-hexagonal, etc.). Ce contribuable doit alors utiliser la déclaration dédiée aux non-résidents, le formulaire n°2042-NR, et le calendrier déclaratif spécifique (généralement équivalent à celui des résidents, avec quelques adaptations).
Les principaux cas particuliers en matière de résidence fiscale
Succession internationale et transmission de patrimoine
En matière successorale, la résidence fiscale peut déterminer la compétence d’imposition des droits de mutation lors du décès. Par exemple, un résident fiscal français détenant des avoirs à l’étranger verra ses héritiers imposés en France sur l’ensemble de son patrimoine mondial, sous réserve des conventions fiscales bilatérales.
Investisseurs immobiliers et expatriés
Un investissement immobilier détenu en France par un expatrié maintient en principe la qualification de revenu de source française (imposable via la déclaration 2042 ou 2042-NR selon le statut). Toutefois, attention si le contribuable rentre souvent ou conserve son foyer en France.À l’opposé, un résident fiscal français acquérant un bien à l’étranger doit déclarer tous les revenus locatifs générés (formulaire n°2047), ainsi que, le cas échéant, l’existence de comptes ouverts à l’étranger via l’imprimé n°3916.
Mobilité professionnelle : détachement, expatriation, retour en France
- Salarié détaché : le salarié envoyé temporairement à l’étranger peut, selon sa situation (conservation de la famille en France, durée du détachement, etc.), rester résident fiscal français. L’imposition suit alors les règles du foyer fiscal français, sous réserve des conventions fiscales.
- Rapatriement : à compter de l’année d’installation ou de retour en France, le contribuable redevient en principe pleinement imposable en France sur la totalité de ses revenus. Les dispositifs incitatifs pour impatriés (article 155 B CGI) peuvent offrir, sous conditions, des exonérations partielles sur certains revenus perçus à l’étranger lors du retour.
Les conséquences fiscales en cas de déclaration inexacte ou d’oubli
Risques de redressement et pénalités
Une mauvaise détermination de la résidence fiscale peut entraîner :
- Un redressement fiscal avec rappel d’impôt sur l’ensemble des revenus mondiaux non déclarés, augmenté des intérêts de retard (0,20 % par mois)
- L’application de majorations pour mauvaise foi (jusqu’à 40 % du montant éludé)
- Des sanctions pénales en cas de manœuvre frauduleuse avérée (cf. articles 1741 et 1743 du CGI)
Ainsi, un investisseur ayant omis de déclarer un compte courant ouvert en Suisse, alors qu’il est résident fiscal français, risque non seulement une amende forfaitaire de 1 500 € par compte non déclaré (article 1649 A CGI), mais aussi, en cas de manquement intentionnel, une majoration de l’impôt dû.
Illustration : sanction liée à un défaut de déclaration d’un compte à l’étranger
Un résident fiscal français ayant perçu, en 2024, 20 000 € d’intérêts sur comptes bancaires ouverts à l’étranger et omis de les déclarer sur le formulaire n°2047 ainsi que le compte sur le formulaire n°3916 s’expose :
- À la réintégration des revenus dans l’assiette imposable
- Aux intérêts de retard calculés sur l’impôt éludé
- À des amendes (1 500 € par compte, voire 10 000 € dans certains pays non coopératifs, voir la liste des États non coopératifs publiée par la DGFiP)
Les démarches et outils pratiques pour sécuriser votre résidence fiscale
Préparer sa déclaration : formulaires et pièces justificatives
Pour déclarer correctement sa résidence fiscale, il est recommandé de rassembler :
- Un justificatif de domicile (facture EDF, bail, relevé de compte indiquant l’adresse)
- Les attestations d’activité professionnelle principale (contrats de travail, bulletins de salaire)
- La ventilation des revenus par pays, mentionnée sur le formulaire n°2047 pour les revenus de source étrangère
- La liste des comptes ouverts, utilisés ou clôturés à l’étranger (à reporter sur l’imprimé n°3916)
La déclaration se fait principalement en ligne via le portail officiel de l’administration fiscale, mais certains non-résidents peuvent encore recourir à la version papier, notamment en l’absence d’accès internet.
Calendriers et échéances 2025
Pour l’imposition des revenus 2024, la déclaration en ligne doit être déposée selon le calendrier suivant :
- Zones 1 (départements 01 à 19) : 25 mai 2025
- Zones 2 (départements 20 à 54) : 1er juin 2025
- Zones 3 (départements 55 à 974/976) : 8 juin 2025
Les non-résidents relevant du Service des impôts des particuliers non-résidents (SIPNR) se font appliquer le délai de la zone 3 (informations sur le SIPNR).
Demande de ruling ou de rescrit fiscal
En cas de situation complexe, il est vivement conseillé de solliciter un rescrit fiscal (interrogation écrite préalable à l’administration fiscale sur l’interprétation à donner à une règle ou à l’application d’une convention). Ce rescrit, adressé au centre des impôts compétent, permet d’obtenir une position officielle et opposable sur le statut de résident.
Les évolutions récentes : jurisprudence et administration
Dernières précisions jurisprudentielles
La jurisprudence du Conseil d’État affine chaque année l’appréciation des critères de résidence. Par exemple, la décision du 7 avril 2021 (CE n°428755) rappelle qu’un contribuable ayant transféré sa résidence fiscale à l’étranger reste résident fiscal français si son foyer familial demeure en France, même en l’absence de revenus français.
Position de l’administration fiscale
L’administration fiscale (notamment Bofip-Impôts) précise régulièrement les critères de rattachement et publie des exemples pratiques dans ses commentaires officiels, qui constituent une base fiable pour anticiper les risques de requalification. Les révisions de la doctrine sont publiées sur bofip.impots.gouv.fr.
Points de vigilance et stratégies pour une gestion optimisée
Anticiper toute mobilité internationale
Avant toute expatriation, retour ou investissement à l’étranger, il est prudent de cartographier votre situation fiscale afin d’anticiper les conséquences déclaratives et patrimoniales en France et à l’étranger.
Sécurisation documentaire
Conserver systématiquement tout justificatif portant sur la vie familiale, le séjour effectif, les intérêts économiques ou l’activité professionnelle permettra, en cas de contrôle, de prouver la sincérité de votre déclaration.
Optimisation patrimoniale
Certaines stratégies, telles que l’utilisation de sociétés patrimoniales, de structures d’investissement adaptées, ou encore le choix avisé des conventions fiscales, permettent d’optimiser la fiscalité tout en restant pleinement conforme à la réglementation.
NB : Ce contenu est fourni à titre informatif et général et ne saurait remplacer un conseil personnalisé et circonstancié. Pour toute étude approfondie de votre situation, le cabinet NBE Avocats vous propose un accompagnement sur-mesure, sécurisé et tenant compte des derniers développements réglementaires et jurisprudentiels. Contactez-nous pour un diagnostic personnalisé.