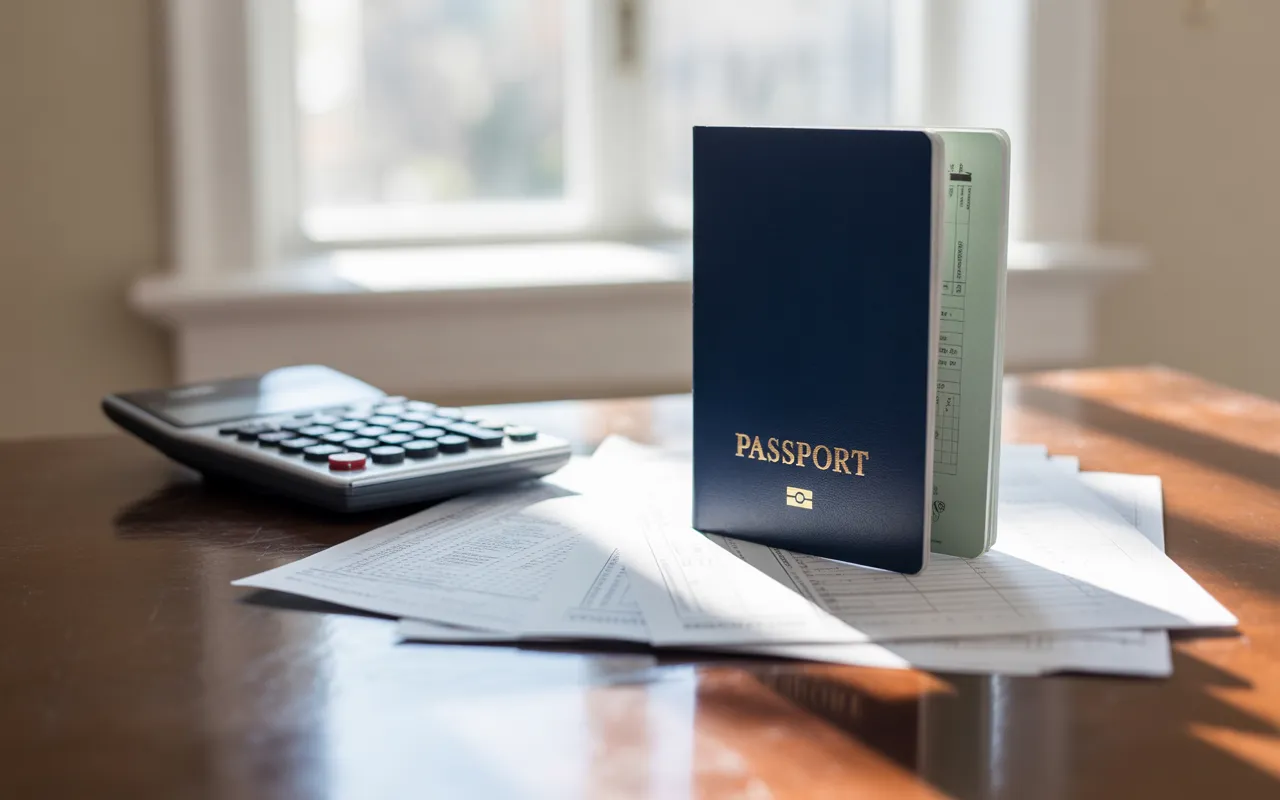La résidence fiscale constitue l’un des éléments clés de la fiscalité internationale, déterminant l’étendue des obligations déclaratives et le traitement fiscal applicable aux expatriés, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales. Comprendre avec précision les critères de résidence fiscale, en France comme à l’étranger, ainsi que leurs impacts, est primordial pour tout contribuable qui envisage ou vit une mobilité internationale, afin d’anticiper risques, opportunités et contraintes liés à l’imposition de ses revenus, de son patrimoine ou de ses plus-values.La situation des expatriés soulève fréquemment la question du rattachement fiscal : à partir de quel moment perd-on le statut de résident fiscal français ? Quels sont les risques de double imposition, les conséquences sur l’Impôt sur le Revenu ou l’IFI, les obligations déclaratives spécifiques, ou encore l’application des conventions fiscales internationales ? Par exemple, un contribuable qui déménage en Espagne en janvier 2024, tout en conservant une résidence en France, devra déterminer où se situe son foyer fiscal principal, là où réside sa famille, et où il exerce son activité professionnelle principale afin de renseigner correctement sa déclaration 2042, à déposer en ligne ou sur papier selon le calendrier fiscal (pour 2024, le service ouvre en avril, avec une date limite comprise entre fin mai et début juin selon le département). Si ce même expatrié perçoit des loyers de biens situés en France, ceux-ci resteront imposables en France en vertu des articles 4 B et 164 B du Code Général des Impôts, sous réserve des stipulations conventionnelles.Pour mieux comprendre les subtilités relatives à la fiscalité internationale et les risques de requalification, notamment en matière de déclaration des revenus mondiaux ou de participation dans des entreprises établies hors de France, vous pouvez consulter notre page dédiée au Droit Fiscal.La question du formulaire fiscal adéquat revêt également une importance pratique : l’utilisation du formulaire 2042-NR (non-résidents) est incontournable pour déclarer les revenus de source française lors de l’année du départ. De même, l’application du prélèvement forfaitaire non libératoire de 20% (ou 30% au-delà de 27 478 € pour 2024) sur ces revenus, sous réserve d’éventuelles demandes de taux moyen, peut avoir des conséquences financières notables. Les actifs patrimoniaux enregistrés dans d’autres juridictions, et la détention d’avoirs à l’étranger, doivent également faire l’objet de déclarations dédiées (formulaire 3916-3916 bis pour les comptes bancaires à l’étranger, par exemple). Pour plus de détails pratiques, le site impots.gouv.fr propose une documentation complète et actualisée.Parmi les enjeux majeurs figure aussi la problématique de l’expatriation des chefs d’entreprise, titulaires de participations substantielles dans des sociétés françaises. Le mécanisme de l’Exit Tax (article 167 bis du CGI), la cristallisation des plus-values latentes lors du transfert du domicile fiscal hors de France, illustre la nécessité d’anticiper juridiquement et fiscalement toute mobilité internationale, dans le respect du droit positif et de la jurisprudence récente du Conseil d’État, notamment en matière de charges de la preuve ou d’application des conventions fiscales bilatérales.Chez NBE Avocats, nous sommes régulièrement sollicités sur ces problématiques complexes, au croisement du droit interne français, du droit conventionnel et des pratiques administratives à jour des dernières évolutions législatives (loi de finances 2024, nouveaux BOFiP, etc.). Cette introduction propose un éclairage général sur la notion de résidence fiscale et ses implications pour les expatriés ; elle ne saurait constituer un conseil personnalisé, chaque situation personnelle ou professionnelle nécessitant une analyse sur-mesure, à réaliser avec l’accompagnement d’avocats fiscalistes. Pour une étude approfondie de votre situation ou un accompagnement dans la sécurisation de votre parcours d’expatriation, contactez notre cabinet.
Définir la résidence fiscale : critères français et internationaux
La résidence fiscale demeure l’une des notions fondatrices du droit fiscal international. Elle conditionne l’assujettissement à l’impôt sur le revenu, à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), et détermine le pays habilité à imposer l’ensemble ou une partie des revenus et du patrimoine d’un contribuable. Comprendre ses critères et ses implications offre au contribuable, particulier ou chef d’entreprise, les clés d’une conformité fiscale rigoureuse et d’une optimisation sereine des flux transfrontaliers.
Les critères de la résidence fiscale en droit interne français
En France, la définition de la résidence fiscale figure principalement à l’article 4 B du Code général des impôts (CGI). Ce texte, complété par la jurisprudence administrative et contentieuse, propose quatre critères alternatifs. Il suffit qu’un seul soit rempli pour que l’administration considère une personne comme résident fiscal français :
- Le foyer ou lieu de séjour principal est situé en France Le foyer s’entend du lieu où la personne (seule ou avec sa famille) réside de façon habituelle, même si ses séjours à l’étranger sont nombreux ou prolongés. Exemple : un cadre détaché en Allemagne, dont l’épouse et les enfants vivent principalement à Paris, pourra être considéré résident fiscal français, sauf stipulation contraire d’une convention fiscale.
- Exercice en France d’une activité professionnelle principale Ce critère vise le lieu d’exercice du travail principal, salarié ou non salarié, sauf si l’activité y est accessoire.
- Centre des intérêts économiques en France Ce critère regarde la localisation principale des investissements, du siège des affaires, ou d’où proviennent les principaux revenus. Exemple : un dirigeant domicilié en Belgique, mais qui tire l’essentiel de ses revenus de sociétés françaises, peut être résident fiscal en France.
- Nationalité Ce critère n’intervient qu’à défaut d’application d’un des trois précédents et dans des cas résiduels ; il recoupe spécifiquement certains cas visés par le code des impôts.
Dans la pratique, la question du “foyer” ou du lieu “de séjour principal” s’avère prépondérante. La jurisprudence du Conseil d’État rappelle qu’il convient d’étudier l’ensemble de la situation : fréquence et durée des séjours, maintien du domicile familial, scolarisation des enfants, etc. Le Conseil d’État publie régulièrement des arrêts sur la définition de la résidence fiscale, consultables sur le site officiel Légifrance.
Distinction entre résidence fiscale et domicile civil
Il est impératif de distinguer le domicile civil (au sens du code civil : lieu du principal établissement d’une personne) de la résidence fiscale. Le domicile fiscal est défini par la loi fiscale, selon ses propres critères, indépendamment de la résidence habituelle ou de l’état civil. Ainsi, un expatrié conservant des attaches sociales ou économiques en France peut y rester fiscalement résident, même en cas d’expatriation civile.
Résidence fiscale et conventions fiscales internationales
Face à la mobilité croissante, les conventions fiscales bilatérales jouent un rôle déterminant pour éviter les doubles impositions. Elles reposent souvent sur le modèle de Convention fiscale de l’OCDE, qui énonce une hiérarchie de critères pour attribuer la résidence fiscale lorsque deux Etats revendiquent la qualité de résident :
- Foyer d’habitation permanent
- Centre des intérêts vitaux
- Lieu de séjour habituel
- Nationalité
Prenons le cas d’un contribuable français qui s’installe en Espagne tout en conservant son appartement à Paris : - Foyer d’habitation permanent : si son logement en Espagne est loué à l’année et qu’il y passe la majorité de son temps, l’Espagne pourrait être considérée comme son foyer principal. - Centre des intérêts vitaux : si sa famille continue à vivre en France, et que la majorité de ses revenus sont perçus en France, la France pourrait revendiquer l’imposition mondiale de ses revenus.La détermination de la résidence fiscale peut alors être tranchée à la lumière de ces critères ; la documentation conventionnelle et le recours à un avocat spécialisé permettent d’éviter les risques de double imposition ou d’arbitrages fiscaux contestés.
Conséquences de la résidence fiscale sur l’imposition en France
La détermination de la résidence fiscale entraîne des implications majeures sur la nature et l’étendue des obligations fiscales en France.
Imposition sur l’ensemble des revenus mondiaux
Un résident fiscal français est imposable en France sur l’intégralité de ses revenus de source française et étrangère (principe de l’imposition mondiale, article 4 A du CGI). Cela inclut :
- Salaires et traitements
- Revenus fonciers
- Revenus mobiliers (dividendes, intérêts)
- Bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux (BNC)
- Revenus de capitaux mobiliers issus de l’étranger
- Plus-values de cession de biens ou de droits situés à l’étranger
Exemple chiffré : Mme D, résidente fiscale française, perçoit en 2023 : - 60 000 € de salaires d’une entreprise française - 20 000 € de loyers d’un appartement à Barcelone - 10 000 € de dividendes de titres américainsElle devra déclarer 90 000 € de revenus mondiaux sur sa déclaration n°2042, tout en pouvant, le cas échéant, imputer certains crédits d’impôt si une convention fiscale prévoit une compensation pour l’impôt effectivement acquitté à l’étranger.En complément, pour ceux qui ont des revenus provenant du numérique ou de l’étranger, des enjeux particuliers liés à la fiscalité des actifs numériques et des données peuvent se poser, pouvant relever aussi du droit NTIC.
Résident fiscal français et IFI
Outre l’impôt sur le revenu, la résidence fiscale conditionne l’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière (article 964 du CGI) :
- Les résidents fiscaux français sont assujettis à l’IFI sur la valeur nette de l’ensemble de leurs biens immobiliers situés en France et à l’étranger excédant 1,3 million d’euros.
- Les non-résidents ne sont imposables que sur les biens immobiliers situés en France.
Exemple : Un contribuable français, possédant une résidence principale à Paris (2M€) et une villa en Italie (1,5M€), devra déclarer la totalité (3,5M€) à l’IFI, malgré la localisation internationale des biens.
Non-résidents : imposition sur les seuls revenus de source française
Un non-résident n’est soumis à l’impôt en France que sur les revenus ou les biens de source française. Il devra alors remplir la déclaration dédiée (formulaire 2042-NR), et sera généralement imposé par voie de prélèvement à la source ou de retenue, dans les conditions du code général des impôts et des conventions fiscales.Exemple : M. F, expatrié au Canada depuis juillet 2023, perçoit des loyers d’un appartement à Lyon. Il devra, au titre de l’année de son départ, remplir deux déclarations : - Un formulaire 2042 portant sur ses revenus mondiaux du 1er janvier à la date de son départ - Un formulaire 2042-NR pour ses seuls revenus de source française du 1er juillet au 31 décembreDes taux de prélèvement spécifiques s’appliquent (minimum 20 % jusqu’à 27 478 € de revenus nets imposables en 2024, puis 30 % au-delà), sauf demande de taux moyen si plus avantageux (sous réserve de justification).
Obligations déclaratives : formulaires et calendrier
La question des déclarations fiscales adaptées revêt un aspect pratique essentiel, aussi bien pour l’année du départ que pour les années ultérieures de non-résidence.
- Déclaration 2042 : classique pour les résidents fiscaux français, à compléter en ligne ou sur papier au printemps de chaque année (en 2024, ouverture du service le 11 avril, date limite comprise entre le 23 mai et le 6 juin selon la région de résidence).
- Déclaration 2042-NR : pour les non-résidents ou les années de mobilité, afin d’isoler les revenus français des contribuables ayant transféré leur domicile fiscal.
- Déclaration 3916/3916-bis : dédiée à l’obligation de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger, mais également des contrats de capitalisation souscrits hors de France. Le non-respect de cette obligation entraîne des sanctions significatives.
- Déclaration IFI : sur la même période, selon les avoirs immobiliers détenus directement ou via des structures juridiques.
La présentation exacte et les notices, régulièrement mises à jour, sont accessibles sur le portail impots.gouv.fr. Il est recommandé de conserver toute documentation justificative des critères de résidence, et d’anticiper, si nécessaire, la constitution de dossiers probants en cas de contrôle fiscal.
Double résidence fiscale et prévention de la double imposition
La mobilité internationale expose nombre de contribuables à la question de la ‘double résidence’, c’est-à-dire le risque d’être considéré résident fiscal dans deux Etats différents la même année.
Risques de conflit de résidence fiscale
Les conflits de résidence fiscale naissent de la divergence des critères retenus par les législations nationales. Un salarié détaché, un chef d’entreprise transfrontalier, ou un investisseur holding peuvent se retrouver dans cette situation.
- Exemple : M. G, ingénieur français, part vivre en Italie tout en maintenant famille et investissements en France. Les deux pays pourraient revendiquer sa résidence au titre de l’année de sa mobilité (foyer en France, activité professionnelle principale en Italie).
Mécanismes de résolution des conflits : les conventions fiscales
Les conventions fiscales bilatérales stipulent des clauses spécifiques de résolution des conflits de résidence, généralement issues du modèle OCDE. L’analyse du cas suppose :
- Détermination de la notion de résident selon chaque législation interne.
- Application des critères graduellement, dans l’ordre prévu par la convention.
- Si le ‘centre des intérêts vitaux’ est indéterminable, on regarde le lieu de séjour habituel, puis la nationalité, et à défaut, est prévu un réglage au niveau administratif (procédure amiable entre Etats).
Le Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE détaille ces procédures et critères de résolution des conflits.Les conventions fiscales précisent aussi les modalités d’imposition, l’octroi de crédits d’impôt ou l’exonération sur certains revenus, et mettent fin à la double imposition.
Modèles conventionnels et exemples de situations
- France-Espagne : la convention pose le foyer d’habitation permanent comme premier critère, puis le centre des intérêts vitaux.
- France-Suisse : des critères similaires s’appliquent, auxquels s’ajoutent des mécanismes d’échange d’informations renforcés.
Dans tous les cas, l’analyse doit se faire au regard du texte conventionnel applicable, de la situation factuelle, et, si besoin, après consultation d’un professionnel du droit.
Incidences patrimoniales et mobilité des dirigeants : l’exemple de l’Exit Tax
La mobilité internationale ne concerne pas que les salariés ou retraités, mais touche tout particulièrement les dirigeants ou actionnaires de sociétés françaises souhaitant s’expatrier.
L’Exit Tax en pratique
Mise en place depuis 2011 (art. 167 bis CGI et suivant), l’Exit Tax vise à lutter contre l’évasion des plus-values latentes lors du transfert du domicile fiscal hors de France. Elle cible principalement :
- Les personnes transférant leur résidence hors de France, détenant directement ou indirectement plus de 50 % d’une société, ou détenant des titres d’une valeur supérieure à 800 000 € au moment du départ
- Elle porte sur les plus-values latentes sur ces participations, sur les créances de complément de prix, et sur les plus-values en report d’imposition
L’imposition est « cristallisée » lors du départ, mais le paiement peut être différé automatiquement en cas de transfert vers l’Union européenne ou un Etat ayant conclu avec la France une convention visant à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.Exemple chiffré Mme H, résidente française, détient 90 % des parts d’une start-up valorisée à 1,5 million d’euros. Elle souhaite s’installer au Portugal. À la date du départ, la plus-value latente sur ses titres, non encore réalisée, est évaluée à 800 000 €. Sauf cas de sursis de paiement (possible en Portugal du fait de la convention), cette plus-value sera théoriquement taxable en France à l’IR et aux prélèvements sociaux. Si elle cède ses titres après son installation à l’étranger, l’imposition française pourra se réaliser, sous réserve de conditions dérogatoires, dans un délai pouvant courir jusqu’à 15 ans en cas de retour en France.La gestion de l’Exit Tax suppose une anticipation stratégique pour limiter les coûts fiscaux et éviter les risques de remise en cause par l’administration.Pour toute question complexe relative à l’expatriation et à la structuration du patrimoine des dirigeants, rapprochez-vous d’un avocat fiscaliste expérimenté.
Transmission du patrimoine, démembrement et trusts
Le transfert de domicile fiscal à l’étranger peut modifier les modalités d’imposition des transmissions de patrimoine, donations, successions (notamment en présence d’avoirs immobiliers ou financiers situés en France ou dans des territoires non conventionnés). La question des trusts, souvent utilisés dans les structurations internationales, impose également des obligations déclaratives spécifiques (formulaire n°2181-TRUST 2), sous peine de sanctions importantes. Des précisions sont disponibles sur le site du Service Public.
Obligations déclaratives internationales : comptes, contrats, actifs numériques
La transparence fiscale constitue un enjeu central de la mobilité et de la gestion internationale de patrimoine.
Déclaration des comptes, contrats et participations détenus à l’étranger
Tout résident fiscal français doit déclarer, lors de sa déclaration annuelle (formulaire 3916/3916-bis), l’ensemble des comptes financiers (bancaires, d’actifs numériques, contrats de capitalisation, assurance-vie, etc.) ouverts, utilisés ou clos à l’étranger, à peine d’amendes significatives (jusqu’à 1 500 € par compte non déclaré ou 10 000 € selon les cas).Exemple : Un résident fiscal français, détenant un compte bancaire en Suisse et un contrat d’assurance-vie au Luxembourg, doit préciser l’ensemble de ces éléments sur sa déclaration 2042-3916-bis, en plus de sa déclaration de revenus.Pour ceux qui détiennent des actifs numériques, comme des cryptomonnaies, les déclarations sont à faire sur les mêmes formulaires, conformément aux précisions de la Direction Générale des Finances Publiques.
Fiscalité des actifs numériques et mobilités internationales
Les résidents fiscaux français, titulaires de portefeuilles de cryptomonnaies sur des plateformes étrangères, sont tenus de déclarer ces comptes (même si non utilisés) sur le formulaire 3916-bis, sous peine de sanctions. Les gains issus d’actifs numériques de source étrangère relèvent de la fiscalité française s’ils sont perçus ou encaissés lors de la période de résidence.
Obligations spécifiques en cas d’installation à l’étranger
En cas de sortie des capitaux, de transferts de patrimoine ou de clôture de comptes, il convient de respecter les formalités de déclaration, mais aussi les délais légaux prévus, pour éviter les rehaussements en cas de contrôle.
Contrôle, contentieux et sécurisation de la résidence fiscale
La question de la résidence fiscale fait l’objet de nombreux contrôles, recoupements d’informations et parfois de contentieux avec l’administration fiscale.
Procédures de contrôle et enjeux de la charge de la preuve
L’administration fiscale dispose d’un faisceau d’indices pour qualifier, ou remettre en cause, la résidence fiscale d’un contribuable. - Séjours en France - Utilisation de moyens de paiement ou de cartes bancaires - Présence de la famille, scolarisation des enfants - Gestion active de sociétés ou tenue de la comptabilité depuis la FranceEn cas de contentieux, la charge de la preuve de la résidence ou de la non-résidence peut incomber à l’un ou l’autre, selon la situation, et implique souvent la production de justificatifs variés (quittances de loyer, factures, preuves d’activité, contrats de scolarité, etc.).La jurisprudence récente du Conseil d’Etat ou des cours administratives d’appel précise régulièrement les contours de ces notions, renforçant la nécessité d’un suivi personnalisé.
Sécurisation de la situation fiscale
L’anticipation et la formalisation documentée du transfert ou du maintien du domicile fiscal sont essentielles : - Lettres de radiation (assurance maladie, liste électorale) - Clôture ou transfert de comptes - Contrats de bail à l’étranger - Information des employeurs, caisses de retraite, URSSAF, etc.Il est recommandé, en cas de doute, de solliciter un rescrit fiscal ou un avis formel de l’administration, via l’accompagnement d’un avocat fiscaliste compétent. Cela permet de limiter les risques de double imposition, de requalification ou de pénalités.
Cas particuliers de la résidence fiscale : étudiants, retraités, frontaliers
Certaines catégories de personnes sont soumises à des aménagements ou à des dispositifs spécifiques en matière de résidence fiscale.
Étudiants internationaux
Un étudiant français partant poursuivre ses études à l’étranger sans y disposer de ressources propres ni de foyer stable (retour régulier en France pendant les vacances, maintien du rattachement familial) demeure en général résident fiscal français. En revanche, les étudiants salariés à l’étranger ou disposant d’une autonomie financière substantielle peuvent, sous conditions, être considérés comme résidents dans l’Etat d’accueil, selon les conventions applicables.
Retraités et pensionnés
La mobilité des retraités pose également des problématiques propres : - Un retraité français installant sa résidence principale au Portugal verra généralement ses pensions privées imposées uniquement au Portugal, sous réserve de la convention fiscale. - Les pensions publiques restent imposables en France même en cas d’expatriation.Les modalités d’imposition sont fixées par les conventions bilatérales, qui prévoient parfois des exceptions ou mécanismes particuliers (crédits d’impôt, exonérations, etc.).
Travailleurs frontaliers
Les salariés transfrontaliers (résidents français travaillant à Monaco, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, etc.) bénéficient parfois de régimes dérogatoires : - Exonération de certains impôts dans l’Etat de résidence sous réserve de travailler dans un périmètre géographique restreint ou de rentrer régulièrement à domicile - Application d’accords spécifiques encadrant la retenue à la source, le partage d’informations et le respect des obligations déclaratives Des informations détaillées sont disponibles sur la rubrique dédiée aux travailleurs frontaliers du site du Ministère de l’Économie.Il convient d’analyser chaque situation à l’aune des textes en vigueur, des stipulations locales, et des instructions administratives actualisées.
Les informations présentées dans cet article le sont à titre informatif et ne remplacent en aucun cas un conseil personnalisé. Chaque situation doit faire l’objet d’une étude approfondie avec un professionnel du droit fiscal. Pour toute question ou sécurisation de votre situation, le cabinet NBE Avocats reste à votre disposition. Rendez-vous également sur notre page d’accueil pour découvrir toutes nos expertises.